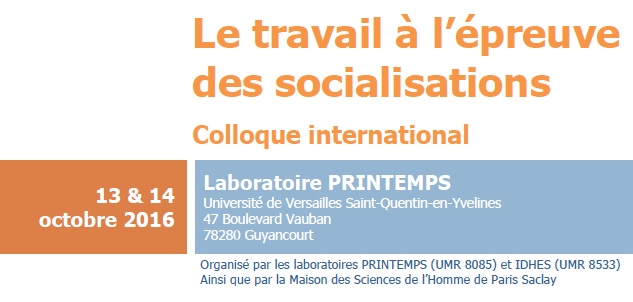Vous êtes ici : PRINTEMPSFRLe PrintempsActualités
- Partager cette page :
- Version PDF
Appel à communications : Colloque international 'Le travail à l'épreuve des socialisations'
Lauréat 2015 des actions soutenues par le DIM GESTES sur financement du Conseil régional d'Île-de-France, ce colloque sera organisé les 13 et 14 octobre 2016 par les laboratoires PRINTEMPS (UMR 8085) et IDHES (UMR 8533) ainsi que par la Maison des Sciences de l'Homme de Paris Saclay.
[style2;Appel à communications]
Depuis près de quarante ans, le travail est l’objet de transformations majeures désormais bien documentées. Dans un contexte de mondialisation des échanges marchands, le glissement progressif d’un « État-providence » à celui d’un modèle tourné vers le marché, l’importance prise par les dynamiques d’innovation et le poids croissant des marchés financiers sur les activités économiques ont entrainé de multiples bouleversements sur la nature et les formes de l’activité salariale, en France et ailleurs : hausse de l’inactivité, fragmentation du marché du travail et des normes d’emploi, restructurations des entreprises, précarisation des conditions de travail, d’emploi et des parcours professionnels, concurrence et pression croissantes sur les travailleurs, exigences de productivité toujours accrues ; mais aussi affaiblissement du syndicalisme et des Institutions Représentatives du Personnel (IRP), etc. Qu’il s’agisse d’identifier leurs causes, d’examiner leur diffusion parmi divers secteurs d’activités ou leurs effets, souvent délétères, sur les salariés, ces « métamorphoses » (Castel, 1994) ont fait l’objet d’une attention et de réflexions majeures quoique parfois contradictoires en sciences sociales. Ainsi, pour Christophe Ramaux (2012), la crise remet moins en cause la stabilité de l’emploi que les formes de la mobilité professionnelle, les mobilités contraintes tendant aujourd’hui à prévaloir sur les mobilités choisies. Et bien que les controverses sur la centralité du travail dans nos sociétés semblent révolues, la nature et l’incidence de ces mutations continuent de susciter une intense production scientifique : si on ne parle plus de « fin du travail », il ne cesse pour autant de subir une dégradation protéiforme et permanente, conduisant au constat, désormais largement partagé, d’une généralisation d’un sentiment de précarité de l’emploi et des conditions de travail (vue parfois comme celle d’une « insécurité sociale »).
L’étude de ces transformations a donc conduit à une vision consensuelle de la détérioration du salariat, invoquée pour justifier l’urgence de « réformes structurelles » aussi bien que le besoin de restaurer des cadres protecteurs. Le projet de ce colloque consiste toutefois à dépasser ces différents examens, en impulsant de nouvelles analyses sur le travail contemporain. Il entend partir de ce constat finalement étonnant, vingt ans après le rapport Boissonnat, au terme de près d’un demi-siècle de transformations, que le travail continue à occuper une place névralgique dans nos sociétés post-industrielles (Davoine, Méda, 2008). Dans la continuité d’un ensemble d’enquêtes et d’approches plus ou moins récentes (Dubar, 1998 ; Darmon, 2010 ; Avril et al., 2010), nous souhaiterions à la fois nous décentrer et enrichir ces débats en nous intéressant à une double dynamique des socialisations professionnelles : en effet, si l’objet de ce colloque consiste à se demander comment le travail conditionne les actions et les représentations des salariés, il s’agira aussi d’interroger la manière dont les normes et valeurs des salariés façonne en retour le travail. Autrement dit, ce colloque vise à décloisonner le travail comme activité sociale spécifique, en envisageant ses relations avec les autres domaines d’activité sociale (famille, loisirs, associations, politique…).
Sans contredire ni minorer les analyses faisant état de l’éclatement des identités et des groupes professionnels, nous faisons l’hypothèse que le travail engendre aujourd’hui également des formes inédites de (re-)production du social et de l’économique qui mériteraient d’être examinées, qu’elles aient trait aux métamorphoses du salariat ou pas, et à des « professions » au sens restreint du terme ou non (Dubar et al., 2013). De fait, la question structurant ce projet de colloque consiste à se demander ce qu’il advient du concept de socialisation professionnelle – entendu le plus souvent comme la façon dont le travail conditionne les identités individuelles et collectives – quand on envisage les dynamiques actuelles du travail et de ses conditions. Il ne s’agit donc pas ici d’interroger les (in-)capacités socialisatrices du travail ; l’objectif est davantage d’étudier les mécanismes et les modalités à partir desquels celui-ci agit sur les travailleurs. Et réciproquement comment ces derniers agissent sur leur activité et le travail en général. Considérant que les espaces et les modes de socialisation ne sont pas juxtaposés les uns aux autres mais bien souvent coexistent ou se concurrencent, il semble en effet qu’aborder la question des socialisations professionnelles ne peut se réduire aux seuls espaces du travail. Dès lors, ce colloque implique de dépasser les frontières et les spécialisations qui isolent les analyses du travail des autres sociologies, mais aussi celles qui séparent les sociologies du travail, de l’activité, des professions et de l’emploi.
Trois pistes principales pourraient être particulièrement propices pour éclairer cette question:
[style1;Axe 1 : Transformations du travail et socialisation professionnelle initiale]
Ce premier axe vise à interroger les différents effets des transformations du travail et de l’emploi sur les formes de socialisation au travail aujourd’hui. Nous souhaiterions étudier tout d’abord l’incidence de ces mutations sur la socialisation initiale des salariés : comment l’expérience et/ou les représentations de ces transformations, notamment des dégradations multiples et différenciées du monde du travail agissent-elles sur les modalités de socialisation professionnelle ? Comment l’évolution des situations professionnelles que connaissent les parents, les membres de sa famille ou de son milieu social, influencent-elles le « choix »ou la « vocation » d’un métier ultérieur ? Certes, Bourdieu (1980) et Beaud (2002), ont contribué à montrer à la fois le poids de l’institution et les effets du déclassement scolaire sur les ressorts de l’engagement au travail. Mais, à l’inverse, dans quelle mesure la fréquentation, même éphémère, d’agents et d’instances d’établissements secondaires ou supérieurs participe-t-elle à la constitution de pratiques et d’identités professionnelles ? Comment le développement de la scolarisation influe-t-il sur les choix professionnels à venir, en remettant en cause l’hérédité sociale du métier (Schwartz, 1998) ? Comment l’attachement à un poste de travail se constitue-t-il malgré la fragmentation et l’allongement éventuel d’accès à un CDI ? Enfin, comment cette initiation complexe, parfois chaotique, au monde du travail pèse-t-elle sur les collectifs professionnels, la syndicalisation ou l’investissement dans l’activité des IRP (Denis, 2005 ; Béroud et al., 2009) ?
[style1;Axe 2 : Trajectoires, (in-)stabilités et socialisations professionnelles]
De la même manière que dans l’axe précédent, on s’intéressera ici aux conséquences des variations des conditions de travail et d’emploi sur les formes d’intégration d’un salarié à un groupe professionnel. Les dynamiques de reproduction, mais aussi de promotions sociales, telles qu’on les retrouve notamment dans les analyses de Bourdieu montrent que la socialisation au travail ne se réduit pas à l’intégration à un groupe professionnel ni à une classe sociale (Quijoux, 2015) : en quoi la mobilité d’une CSP à une autre au cours d’une carrière affecte-t-elle le rapport des salariés à leur univers de travail ? Comment les restructurations d’une activité, d’une entreprise, d’un secteur, agissent-elles sur l’identité et un groupe de salariés ? Comment les expériences du chômage ou du temps partiel façonnent-elles de nouvelles sources d’identification et de catégorisation professionnelles ? Ces transformations produisent-elles de nouvelles normes, valeurs et pratiques sur leur travail et/ou leurs professions ? En quoi modifient-elles les schèmes de représentation et d’action et les contours de l’appartenance professionnelle ? De quelle manière les transformations de l’activité et des conditions de travail agissent-elles sur les collectifs pertinents de socialisation, en remettant en cause les identifications à un ou des métiers ? Enfin, quels sont les effets d’une part croissante d’innovation et de recherche dans le travail, contribuant à remettre en cause ses équipements, ses produits et son organisation ?
Dans ce second axe, il ne s’agira pas toutefois uniquement d’examiner les effets socialisateurs des transformations du monde du travail (notamment à partir de trajectoires soumises à des variations ou discontinues). S’il semble crucial d’accorder une attention particulière aux univers professionnels ayant subi d’importantes mutations, la recherche d’une vision d’ensemble implique d’intégrer les univers professionnels présentés comme moins soumis à la précarisation. En effet, il sera aussi question d’aborder les formes salariales qui n’ont pas nécessairement connu d’évolutions majeures ni au niveau de la structure de l’emploi ni à celui des conditions d’exercice de leur activité – salariés « stables », travailleurs de la fonction publique, professions réglementées, etc. : comment l’intégration salariale socialise-t-elle aujourd’hui ? Suivant les indications de Darmon d’un côté (ibid.), et d’Avril, Cartier et Serre de l’autre (ibid.), il s’agira d’étudier de façon complémentaire les processus en cours, les agents et instances au cœur de ces processus et les effets concrets de ces socialisations. Sur quelles bases se définit-on comme travailleur aujourd’hui ? Quels effets l’accès à un « segment plus intégré » du marché du travail a-t-il dans un monde salarial objectivement et subjectivement de plus en plus fragmenté ?
[style1;Axe 3 : La socialisation professionnelle entre travail et hors-travail]
Le travail est souvent envisagé par une approche centrée sur l’activité, l’entreprise, le métier ou la branche. Or, loin d’être un univers cloisonné, le monde professionnel se superpose aux univers domestiques, familiaux, scolaires, associatifs, politiques, sportifs ou religieux. Dans la mesure où il confronte des individus issus de milieux sociaux différents, le monde du travail constitue un espace de circulation de normes et de pratiques sociales, politiques et culturelles. Dès lors, le monde du travail est le creuset d’un ensemble de valeurs, de représentations et d’actions qui lui sont propres. S’il est aussi le lieu à la fois de réception, de retraduction et d’émission de schèmes de perception et d’action issus du hors-travail, il est également porteur de valeurs qui transforment ce hors-travail. Comme le montre Bourdieu dans le cas de l’Algérie, le travail s’impose comme une activité distincte des autres activités sociales telles que les activités familiales, en contribuant à leur « rationalisation » (1970). Le développement de l’activité des femmes depuis les années 1960 conduit ainsi à sortir d’une vision traditionnaliste de la famille comme îlot de stabilité tutélaire (Maruani, 2011), pour analyser une dynamique plus large où le travail féminin est également source d’une liberté de choix plus grande, qui affecte les évolutions de la famille (de Singly, 1996). C’est donc l’exploration de ce continuum entre travail et hors-travail, de ce qu’il produit et de ce qu’il véhicule qui nous paraît particulièrement heuristique pour la saisie des socialisations professionnelles contemporaines. A cet égard, analyser les transformations du monde du travail constitue une nouvelle piste : on peut se demander en effet dans quelle mesure l’affaiblissement du salariat favorise une plus grande porosité entre travail et hors-travail ; et réciproquement dans quelle mesure l’existence et les frontières du hors-travail sont remises en cause par les récents développements du salariat et bouleverse-t-il des univers tels que la famille ?
En somme, dans la continuité des réflexions anciennes et actuelles du laboratoire PRINTEMPS sur le travail et les socialisations, ce colloque vise un objectif à la fois simple et ambitieux : résolument ouvert à toutes les méthodes de recherche et disciplines, à tous les secteurs d’activités mais aussi à toutes les régions du monde, cet évènement entend décloisonner les analyses du travail pour mieux resituer sa centralité dans la compréhension des phénomènes sociaux.
[style1;Propositions de communication]
Les propositions de communication doivent être envoyées à maxime.quijoux@uvsq.fr, au plus tard le 1er février 2016, et ne pas dépasser 5000 signes.
Les textes des communications devront ensuite parvenir à la même adresse au plus tard le 1er juillet 2016.


Depuis près de quarante ans, le travail est l’objet de transformations majeures désormais bien documentées. Dans un contexte de mondialisation des échanges marchands, le glissement progressif d’un « État-providence » à celui d’un modèle tourné vers le marché, l’importance prise par les dynamiques d’innovation et le poids croissant des marchés financiers sur les activités économiques ont entrainé de multiples bouleversements sur la nature et les formes de l’activité salariale, en France et ailleurs : hausse de l’inactivité, fragmentation du marché du travail et des normes d’emploi, restructurations des entreprises, précarisation des conditions de travail, d’emploi et des parcours professionnels, concurrence et pression croissantes sur les travailleurs, exigences de productivité toujours accrues ; mais aussi affaiblissement du syndicalisme et des Institutions Représentatives du Personnel (IRP), etc. Qu’il s’agisse d’identifier leurs causes, d’examiner leur diffusion parmi divers secteurs d’activités ou leurs effets, souvent délétères, sur les salariés, ces « métamorphoses » (Castel, 1994) ont fait l’objet d’une attention et de réflexions majeures quoique parfois contradictoires en sciences sociales. Ainsi, pour Christophe Ramaux (2012), la crise remet moins en cause la stabilité de l’emploi que les formes de la mobilité professionnelle, les mobilités contraintes tendant aujourd’hui à prévaloir sur les mobilités choisies. Et bien que les controverses sur la centralité du travail dans nos sociétés semblent révolues, la nature et l’incidence de ces mutations continuent de susciter une intense production scientifique : si on ne parle plus de « fin du travail », il ne cesse pour autant de subir une dégradation protéiforme et permanente, conduisant au constat, désormais largement partagé, d’une généralisation d’un sentiment de précarité de l’emploi et des conditions de travail (vue parfois comme celle d’une « insécurité sociale »).
L’étude de ces transformations a donc conduit à une vision consensuelle de la détérioration du salariat, invoquée pour justifier l’urgence de « réformes structurelles » aussi bien que le besoin de restaurer des cadres protecteurs. Le projet de ce colloque consiste toutefois à dépasser ces différents examens, en impulsant de nouvelles analyses sur le travail contemporain. Il entend partir de ce constat finalement étonnant, vingt ans après le rapport Boissonnat, au terme de près d’un demi-siècle de transformations, que le travail continue à occuper une place névralgique dans nos sociétés post-industrielles (Davoine, Méda, 2008). Dans la continuité d’un ensemble d’enquêtes et d’approches plus ou moins récentes (Dubar, 1998 ; Darmon, 2010 ; Avril et al., 2010), nous souhaiterions à la fois nous décentrer et enrichir ces débats en nous intéressant à une double dynamique des socialisations professionnelles : en effet, si l’objet de ce colloque consiste à se demander comment le travail conditionne les actions et les représentations des salariés, il s’agira aussi d’interroger la manière dont les normes et valeurs des salariés façonne en retour le travail. Autrement dit, ce colloque vise à décloisonner le travail comme activité sociale spécifique, en envisageant ses relations avec les autres domaines d’activité sociale (famille, loisirs, associations, politique…).
Sans contredire ni minorer les analyses faisant état de l’éclatement des identités et des groupes professionnels, nous faisons l’hypothèse que le travail engendre aujourd’hui également des formes inédites de (re-)production du social et de l’économique qui mériteraient d’être examinées, qu’elles aient trait aux métamorphoses du salariat ou pas, et à des « professions » au sens restreint du terme ou non (Dubar et al., 2013). De fait, la question structurant ce projet de colloque consiste à se demander ce qu’il advient du concept de socialisation professionnelle – entendu le plus souvent comme la façon dont le travail conditionne les identités individuelles et collectives – quand on envisage les dynamiques actuelles du travail et de ses conditions. Il ne s’agit donc pas ici d’interroger les (in-)capacités socialisatrices du travail ; l’objectif est davantage d’étudier les mécanismes et les modalités à partir desquels celui-ci agit sur les travailleurs. Et réciproquement comment ces derniers agissent sur leur activité et le travail en général. Considérant que les espaces et les modes de socialisation ne sont pas juxtaposés les uns aux autres mais bien souvent coexistent ou se concurrencent, il semble en effet qu’aborder la question des socialisations professionnelles ne peut se réduire aux seuls espaces du travail. Dès lors, ce colloque implique de dépasser les frontières et les spécialisations qui isolent les analyses du travail des autres sociologies, mais aussi celles qui séparent les sociologies du travail, de l’activité, des professions et de l’emploi.
Trois pistes principales pourraient être particulièrement propices pour éclairer cette question:
[style1;Axe 1 : Transformations du travail et socialisation professionnelle initiale]
Ce premier axe vise à interroger les différents effets des transformations du travail et de l’emploi sur les formes de socialisation au travail aujourd’hui. Nous souhaiterions étudier tout d’abord l’incidence de ces mutations sur la socialisation initiale des salariés : comment l’expérience et/ou les représentations de ces transformations, notamment des dégradations multiples et différenciées du monde du travail agissent-elles sur les modalités de socialisation professionnelle ? Comment l’évolution des situations professionnelles que connaissent les parents, les membres de sa famille ou de son milieu social, influencent-elles le « choix »ou la « vocation » d’un métier ultérieur ? Certes, Bourdieu (1980) et Beaud (2002), ont contribué à montrer à la fois le poids de l’institution et les effets du déclassement scolaire sur les ressorts de l’engagement au travail. Mais, à l’inverse, dans quelle mesure la fréquentation, même éphémère, d’agents et d’instances d’établissements secondaires ou supérieurs participe-t-elle à la constitution de pratiques et d’identités professionnelles ? Comment le développement de la scolarisation influe-t-il sur les choix professionnels à venir, en remettant en cause l’hérédité sociale du métier (Schwartz, 1998) ? Comment l’attachement à un poste de travail se constitue-t-il malgré la fragmentation et l’allongement éventuel d’accès à un CDI ? Enfin, comment cette initiation complexe, parfois chaotique, au monde du travail pèse-t-elle sur les collectifs professionnels, la syndicalisation ou l’investissement dans l’activité des IRP (Denis, 2005 ; Béroud et al., 2009) ?
[style1;Axe 2 : Trajectoires, (in-)stabilités et socialisations professionnelles]
De la même manière que dans l’axe précédent, on s’intéressera ici aux conséquences des variations des conditions de travail et d’emploi sur les formes d’intégration d’un salarié à un groupe professionnel. Les dynamiques de reproduction, mais aussi de promotions sociales, telles qu’on les retrouve notamment dans les analyses de Bourdieu montrent que la socialisation au travail ne se réduit pas à l’intégration à un groupe professionnel ni à une classe sociale (Quijoux, 2015) : en quoi la mobilité d’une CSP à une autre au cours d’une carrière affecte-t-elle le rapport des salariés à leur univers de travail ? Comment les restructurations d’une activité, d’une entreprise, d’un secteur, agissent-elles sur l’identité et un groupe de salariés ? Comment les expériences du chômage ou du temps partiel façonnent-elles de nouvelles sources d’identification et de catégorisation professionnelles ? Ces transformations produisent-elles de nouvelles normes, valeurs et pratiques sur leur travail et/ou leurs professions ? En quoi modifient-elles les schèmes de représentation et d’action et les contours de l’appartenance professionnelle ? De quelle manière les transformations de l’activité et des conditions de travail agissent-elles sur les collectifs pertinents de socialisation, en remettant en cause les identifications à un ou des métiers ? Enfin, quels sont les effets d’une part croissante d’innovation et de recherche dans le travail, contribuant à remettre en cause ses équipements, ses produits et son organisation ?
Dans ce second axe, il ne s’agira pas toutefois uniquement d’examiner les effets socialisateurs des transformations du monde du travail (notamment à partir de trajectoires soumises à des variations ou discontinues). S’il semble crucial d’accorder une attention particulière aux univers professionnels ayant subi d’importantes mutations, la recherche d’une vision d’ensemble implique d’intégrer les univers professionnels présentés comme moins soumis à la précarisation. En effet, il sera aussi question d’aborder les formes salariales qui n’ont pas nécessairement connu d’évolutions majeures ni au niveau de la structure de l’emploi ni à celui des conditions d’exercice de leur activité – salariés « stables », travailleurs de la fonction publique, professions réglementées, etc. : comment l’intégration salariale socialise-t-elle aujourd’hui ? Suivant les indications de Darmon d’un côté (ibid.), et d’Avril, Cartier et Serre de l’autre (ibid.), il s’agira d’étudier de façon complémentaire les processus en cours, les agents et instances au cœur de ces processus et les effets concrets de ces socialisations. Sur quelles bases se définit-on comme travailleur aujourd’hui ? Quels effets l’accès à un « segment plus intégré » du marché du travail a-t-il dans un monde salarial objectivement et subjectivement de plus en plus fragmenté ?
[style1;Axe 3 : La socialisation professionnelle entre travail et hors-travail]
Le travail est souvent envisagé par une approche centrée sur l’activité, l’entreprise, le métier ou la branche. Or, loin d’être un univers cloisonné, le monde professionnel se superpose aux univers domestiques, familiaux, scolaires, associatifs, politiques, sportifs ou religieux. Dans la mesure où il confronte des individus issus de milieux sociaux différents, le monde du travail constitue un espace de circulation de normes et de pratiques sociales, politiques et culturelles. Dès lors, le monde du travail est le creuset d’un ensemble de valeurs, de représentations et d’actions qui lui sont propres. S’il est aussi le lieu à la fois de réception, de retraduction et d’émission de schèmes de perception et d’action issus du hors-travail, il est également porteur de valeurs qui transforment ce hors-travail. Comme le montre Bourdieu dans le cas de l’Algérie, le travail s’impose comme une activité distincte des autres activités sociales telles que les activités familiales, en contribuant à leur « rationalisation » (1970). Le développement de l’activité des femmes depuis les années 1960 conduit ainsi à sortir d’une vision traditionnaliste de la famille comme îlot de stabilité tutélaire (Maruani, 2011), pour analyser une dynamique plus large où le travail féminin est également source d’une liberté de choix plus grande, qui affecte les évolutions de la famille (de Singly, 1996). C’est donc l’exploration de ce continuum entre travail et hors-travail, de ce qu’il produit et de ce qu’il véhicule qui nous paraît particulièrement heuristique pour la saisie des socialisations professionnelles contemporaines. A cet égard, analyser les transformations du monde du travail constitue une nouvelle piste : on peut se demander en effet dans quelle mesure l’affaiblissement du salariat favorise une plus grande porosité entre travail et hors-travail ; et réciproquement dans quelle mesure l’existence et les frontières du hors-travail sont remises en cause par les récents développements du salariat et bouleverse-t-il des univers tels que la famille ?
En somme, dans la continuité des réflexions anciennes et actuelles du laboratoire PRINTEMPS sur le travail et les socialisations, ce colloque vise un objectif à la fois simple et ambitieux : résolument ouvert à toutes les méthodes de recherche et disciplines, à tous les secteurs d’activités mais aussi à toutes les régions du monde, cet évènement entend décloisonner les analyses du travail pour mieux resituer sa centralité dans la compréhension des phénomènes sociaux.
[style1;Propositions de communication]
Les propositions de communication doivent être envoyées à maxime.quijoux@uvsq.fr, au plus tard le 1er février 2016, et ne pas dépasser 5000 signes.
Les textes des communications devront ensuite parvenir à la même adresse au plus tard le 1er juillet 2016.


A télécharger
Propositions de communication
Les propositions de communication doivent être envoyées à maxime.quijoux@uvsq.fr, au plus tard le 1er février 2016, et ne pas dépasser 5000 signes.